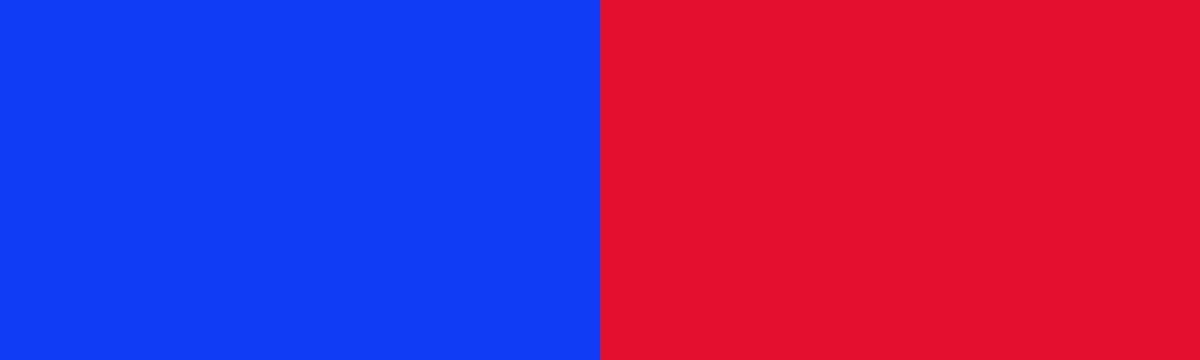Dans le cadre de la rétrospective COZIC. À vous de jouer. De 1967 à aujourd’hui, présentée au Musée nationale des beaux-arts du Québec du 10 octobre au 5 janvier 2020, Esse propose une discussion entre Ariane De Blois, commissaire de l’exposition, et Monic Brassard et Yvon Cozic, les deux artistes derrière COZIC.
Ariane De Blois : Vous vous êtes connus à l’École des beaux-arts au début des années 1960 et avez commencé à travailler ensemble vers la fin de la décennie. La formation que vous avez reçue était très académique. C’est d’ailleurs en partie ce qui a mené à l’occupation de l’institution en 1968, quelques années après votre départ de celle-ci. Comment expliquez-vous que l’enseignement avait si peu évolué depuis la publication du Refus global ? Comment perceviez-vous votre formation et d’où tiriez-vous vos sources d’inspiration ?
Yvon Cozic : Dans les ateliers, l’approche était encore très académique. Avec un certain décalage, elle était principalement tournée vers ce qui se faisait en France. Pour une raison quelconque, les professeurs, issus pour la plupart de la branche de Prisme d’Yeux, suivaient le cursus imposé. Mais nous avons eu la chance d’avoir François-Marc Gagnon comme professeur d’histoire de l’art et c’est lui qui nous a éveillés aux différents courants modernes comme le surréalisme, le dadaïsme ou encore l’automatisme.
Monic Brassard : Nous constations que l’enseignement était un peu figé, nous rouspétions parfois un peu contre certaines manières de faire, mais nous ne nous sentions pas étouffés pour autant. À notre entrée à l’École des beaux-arts à l’âge de 16-17 ans nous n’avions aucune connaissance de l’histoire de l’art. L’enseignement académique nous a permis de découvrir un tas de choses. Autrement, on suivait de près ce qui venait de New York, comme les grandes toiles, les grands formats, alors qu’à l’école on travaillait encore la peinture de chevalet. L’influence de New York était telle qu’on y allait entre amis au moins deux fois par année pour voir ce qui se faisait et, chaque fois, on avait hâte de retourner dans nos ateliers pour travailler sur nos projets. Nous ramenions aussi très souvent des matériaux que nous ne trouvions pas ici.
ADB : Une fois vos études complétées, comment s’est passé votre devenir professionnel ?
MB : Au début, Montréal était la métropole artistique au Canada et la peinture, surtout celle des Plasticiens, prenait toute la place, autant du point de vue du discours que du marché de l’art. Quand les Francine Larrivée, Pierre Ayot, Serge Lemoyne, Suzy Lake, Serge Tousignant et nous sommes arrivés, les galeries n’étaient pas du tout prêtes à recevoir nos pratiques. Il n’y avait pas de place pour les jeunes. C’est essentiellement pour diffuser les nouvelles pratiques que les galeries parallèles comme Média Gravure et Véhicule Art ont été fondées. Les centres d’artistes ont par la suite vu le jour. Les galeries marchandes ont fermé une à une ou ont déménagé à Toronto.
ADB : Les années 1960 et 1970 sont consacrées à l’expérimentation. Vous avez activement participé au changement de paradigme entre l’art moderne et l’art contemporain à travers le décloisonnement des disciplines. Quelles étaient vos relations avec les artistes de la contreculture ?
MB : C’était une époque d’éclatement. Il y avait des regroupements d’artistes mais aucun mouvement précis ou école de pensée. Nous étions proches de plusieurs artistes comme Pierre Ayot, Serge Lemoyne et Gilles Boisvert. Nous discutions d’art et de nos productions respectives, mais nous ne développions pas conjointement de principes plastiques à suivre. Nous ne voulions pas de contraintes, pas de règles, pas de dogmes en ce qui a trait à la création et surtout ne pas faire la même chose.
YC : Ce qui nous unissait par-dessus tout, c’était le désir de démocratiser l’art.
ADB : En phase avec les bouleversements sociaux de la Révolution tranquille, les artistes de votre génération étaient pour la plupart très engagés politiquement. Plusieurs évènements, comme l’Opération Déclic en 1968, ont été organisés pour réfléchir au rôle de l’art et de l’artiste en société, et pour réclamer un soutien de l’État à la création. De quelle nature était votre implication dans ces débats ?
YC : Nous étions très favorables aux idées véhiculées concernant le rapprochement de l’art et de la société, et notre pratique en était fortement imprégnée. Nous avons pris part aux mouvements et aux manifestations comme Opération Déclic, mais nous ne pouvions pas participer de manière très active pour des raisons de survie familiale. À cette époque peu d’artistes de notre génération avaient des enfants. Nous étions toutefois toujours très présents aux activités artistiques.
ADB : Ce qui est particulier chez les artistes de votre génération, c’est que vous avez œuvré autant hors des lieux convenus de l’art qu’au sein des institutions. Ces dernières ont rapidement accepté et diffusé votre travail, contrairement aux œuvres des artistes modernes, comme celles des Automatistes, qui ont initialement été rejetées.
YC : Les changements au Québec se sont faits de manière très rapide. L’éveil d’une époque nous a permis d’aller plus loin. Dans les années 1960 et 1970, nous exposions autant dans les centres d’achats qu’au Musée d’art contemporain où c’était relativement facile d’exposer puisqu’il n’y avait pas de liste d’attente. Le musée, qui venait d’ouvrir ses portes, s’est beaucoup nourri du milieu. C’était un lieu de rassemblement pour les artistes. La communauté francophone, en tout cas, s’est beaucoup identifiée au MAC. On ne ratait pas un vernissage.
ADB : A vos débuts pensiez-vous que l’art pouvait provoquer des changements concrets dans la société ?
MB : On croyait véritablement que l’art pouvait être plus présent dans la vie de tous les jours, qu’il pouvait changer le regard des gens et influencer leurs choix. C’était utopique. Les gens fréquentent peut-être un peu plus les musées mais l’art ne fait pas partie de leur vie. Pour nous, par contre, être artiste était une façon de vivre. La réflexion et la remise en question se faisaient sur tous les plans de notre existence. Notre façon d’éduquer nos enfants, d’être parents, de travailler, d’enseigner, de nous habiller. Par exemple, je nous confectionnais des vêtements différents pour chaque vernissage, une façon de montrer qu’être artistes fait partie de chaque petit geste.
ADB : Cette vision intégrée de l’art vous l’avez vécue, vous l’avez incarnée en faisant de votre pratique artistique un mode de vie. C’est du point de vue sociétal que le pont entre l’art et la vie ne s’est pas fait. Vous souhaitiez en quelque sorte que l’art puisse franchir le seuil des foyers, un peu comme la musique populaire, et qu’il participe ainsi à l’émergence d’une société nouvelle, plus solidaire. Nous sommes en effet loin de cette réalité, la transformation sociétale grâce à l’art a échoué.
YC : En ce qui nous concerne, c’est vrai que nous nous sommes toujours organisés pour avoir notre atelier à la maison afin que le geste artistique soit intégré à notre vie quotidienne. Mais pour le reste de la société, l’arrimage entre l’art et la vie ne s’est pas concrétisé. Il suffit de constater la difficulté des médias à parler d’art contemporain et actuel.
MB : Avec le recul, je dirais que c’est bien beau vouloir plaire à un plus grand nombre, mais la journée où l’on va y arriver en tant que discipline, on risque de priver les artistes d’une certaine liberté. Il y aura une demande à laquelle les artistes devront répondre, quitte à faire des compromis importants quant à leur pratique. Par exemple, quand les premières œuvres d’art intégrées à l’architecture sont apparues les gens étaient choqués. Malgré la contestation, les artistes étaient plus libres qu’aujourd’hui. Nous avons cessé de faire des œuvres d’art public, car il y a trop de contraintes. À trop vouloir être accepté, on se démarginalise. Pour l’artiste, c’est un privilège d’être marginal, et aujourd’hui je remarque que les artistes sont en train d’être piégés. Ils ont des contrats et sont obligés de respecter les règles. C’est un fichu piège !
ADB : L’histoire de l’art nous apprend que les artistes ont beaucoup travaillé selon des contraintes. On n’a qu’à penser aux nombreuses commandes de l’Église durant la Renaissance où les artistes ont dû répondre à des contrats très précis. Pour vous, travailler ainsi, ce n’est pas envisageable ?
MB : Pour nous la liberté est primordiale et cela signifie avoir la possibilité d’être contre certaines règles, c’est-à-dire avoir le loisir d’être dans la marge.
ADB : À cet égard, quels sont vos sentiments vis-à-vis une rétrospective au Musée national des beaux-arts du Québec ?
YC : Cette rétrospective permet de rejoindre un plus large public et éclaire certaines choses sur l’ensemble de la pratique dans l’esprit des gens. Plusieurs personnes, même parmi celles qui connaissent bien notre travail, nous ont dit avoir fait des découvertes. Nous redécouvrons aussi notre production et éprouvons une certaine nostalgie face au temps qui passe, face à notre propre vieillissement.
MB : L’exposition présente ce qui était marginal au moment où il a été fait. Nous avons toujours travaillé dans l’instant présent, sans nous projeter vers l’avenir. Notre travail nous semble encore très actuel et j’en suis heureuse. Depuis quelques années, il suscite un intérêt renouvelé, particulièrement chez les jeunes artistes, ce qui nous fait plaisir. Par ailleurs, comme nous n’avons pas de disciples directs, cela signifie que notre travail est toujours un peu dans la marge.
ADB : Pouvez-vous revenir brièvement sur le concept derrière COZIC et la raison pour laquelle vous avez choisi ce nom pour identifier votre production commune ?
MB : Dès le départ notre idée était de subvertir le statut de l’artiste. À cette époque, contrairement à aujourd’hui, les duos et les collectifs d’artistes étaient presque inexistants. Nous voulions travailler à deux, mais nous ne voulions pas signer Monic Brassard et Yvon Cozic. Nous désirions avoir une appellation commune. Cozic, un nom rare, nous paraissait idéal comme signature, entre autres à cause de sa sonorité particulière, facile à retenir.
ADB : En épluchant les documents de presse, j’ai été frappée de constater la fréquence à laquelle Monic, tu as été citée « en relation » à Yvon, c’est-à-dire comme étant son épouse ou une simple collaboratrice et non comme une artiste à part entière. Le concept de l’artiste à deux têtes semble avoir pris un certain temps à s’imposer et a porté un certain ombrage à ton travail, n’est-ce pas ?
MB : Dans le milieu, non. C’est plutôt au niveau de l’écrit que les choses se sont compliquées. Les gens n’arrivaient pas à se faire à l’idée d’utiliser seulement COZIC. Ils sentaient le besoin d’ajouter un prénom. Peut-être parce que l’emploi d’un nom de famille seul, sans prénom, pouvait être perçu comme une entorse à l’étiquette.
ADB : Le fait que votre entité commune porte le nom du patronyme d’Yvon a dû participer à la confusion, surtout avec les revendications féministes du moment. Monic, tu as d’ailleurs abandonné le nom Cozic dans ta vie courante vers 1970.
MB : Cela a joué pour beaucoup, c’est certain, mais cela m’importait peu à ce moment-là. Cozic, au début, c’était mon nom, celui de notre fille. C’était un nom d’artiste. Il me semblait évident que j’étais là alors je ne ressentais pas la nécessité de mettre les points sur les i. Je ne pensais pas à l’histoire. Yvon allait davantage vers les critiques, tout simplement parce que cela ne me plaisait pas particulièrement. Lorsque j’ai compris les enjeux, je me suis faite plus présente, mais ce qui m’intéressait et ce qui m’intéresse encore, c’est d’être dans l’atelier et de faire des œuvres.
ADB : D’ailleurs, la raison pour laquelle j’ai choisi d’afficher à l’entrée de l’exposition, un portrait de vous deux dans l’atelier dans lequel Monic tient fermement sa machine à coudre, c’était pour réaffirmer sa présence dès les débuts de COZIC avec la confection des œuvres molles en tissu. La présence de Monic s’incarne dans le geste artistique et c’est pour cette raison que j’ai axé l’exposition autour de cette idée, notamment avec l’inclusion d’une reconstitution de votre atelier.
Votre pratique est si riche qu’elle est difficile à circonscrire. Vous avez œuvré à la fois de manière avant-gardiste et à contrecourant. Vous avez exploré différents moyens d’expression, exposé autant dans les musées que hors de ses murs. L’usage de matériaux usuels et la fabrication manuelle sont des fils rouges de votre production, tout comme la coexistence de contrastes au sein de vos pièces (recherche formelle/excès, forme/antiforme, culture savante/culture populaire), l’exploration de la couleur et de l’espace. Le registre ludique est aussi présent dans votre travail, mais il côtoie toujours une importante dimension poétique. Avec un regard sur le passé comment décrivez-vous votre production ?
YC : Notre production a été marquée par notre formation académique. J’y dénote un désir constant de travailler la composition, nous cherchons à équilibrer plastiquement les choses. Par ailleurs, nous aimons aussi travailler sur les seuils. Le fait d’ajouter des éléments qui viennent troubler la structure de l’œuvre, sans forcément la détruire, nous fascine depuis toujours. C’est une manière pour nous d’en complexifier la lecture.
MB : Notre œuvre, selon moi, porte en elle une très grande charge poétique. Cela s’exprime à travers la rencontre improbable de matériaux, dans le désir constant d’élargir notre vocabulaire plastique et de multiplier nos sources d’inspiration. La poésie s’exprime aussi dans la manière sensible qu’ont les œuvres d’aborder certains sujets qui touchent à l’existence humaine et à l’environnement.
ADB : Vous travaillez de manière sérielle autour d’« obsessions ». Ainsi, vos œuvres sont ponctuées de revirements plastiques et esthétiques importants qui s’apparentent à des « ruptures ». Pensons entre autres au passage entre les sculptures molles et la série Cocotte. Comment expliquez-vous l’évolution de votre pratique ? Qu’est-ce qui motive le passage d’une série à une autre ? Quand considérez-vous qu’une série est terminée ?
MB : La naissance d’une obsession a toujours comme origine une rencontre, avec un matériau, une idée ou un concept. Le défi de cette découverte suscite le désir d’en subvertir la fonction initiale, ce qui donne lieu à une série. Nous n’avons jamais été intéressés à inscrire notre pratique dans une continuité. Après les Plasticiens, il y avait un questionnement sur la mort de la peinture. Cette question ne nous intéressait pas. Pour nous la peinture, c’est la couleur. Et la couleur peut se trouver autant dans les tissus que dans les objets trouvés. Notre pratique s’adapte selon nos trouvailles et nos envies. Une fois qu’une série est entamée, nous nous questionnons sur la pertinence de la poursuivre. Lorsque nous croyons que le public peut imaginer la suite, nous passons à autre chose.
YC : Sans que cela soit planifié, il y a souvent un élément d’une série qui réapparait dans une autre. C’est sans doute ces résurgences, qui unissent les séries entre elles, qui constituent la particularité de notre vocabulaire plastique. Ainsi, il n’y a pas de réelle rupture.
ADB : Votre travail est au confluent de plusieurs mouvements contemporains, comme le pop art, l’arte povera ou l’antiforme au début de votre pratique, mais il n’appartient à aucune école précise. Vous refusez d’ailleurs de vous identifier à un mouvement en particulier. Pouvez-vous expliquer le cheminent de vos influences ?
MB : C’est difficile à deux d’identifier des influences précises. L’intérêt de l’un se transforme une fois qu’il est communiqué à l’autre. Il n’y a plus d’influence en ligne directe. Il y a surement une certaine forme de perméabilité face aux réalités d’une époque. Il y a par moment des effets de synchronicité avec les pratiques qui nous sont contemporaines.
YC : Cela dénote que les artistes ont des antennes et captent les choses sans forcément les rechercher.
ADB : Votre pratique s’intéresse au décloisonnement des arts. Toutefois, je remarque que vous n’avez jamais intégré les arts médiatiques et les nouvelles technologies dans votre grammaire plastique. Est-ce le fruit d’une posture ou d’un refus systématique ?
MB : Ce qui est important pour nous, c’est le faire, le contact avec les matériaux. C’est entre autres ce qui a dicté la dimension des œuvres. Même celles qui prennent beaucoup d’espace, ce sont des œuvres que nous pouvons transporter nous-mêmes, que nous pouvons soulever à deux. Nous étions déjà deux à travailler et nous ne voulions pas intégrer une technologie que nous ne contrôlions pas. Ce qu’on aimait, c’est faire, et faire du début à la fin.
ADB : Pouvez-vous élaborer sur la manière dont vous choisissez vos titres. Ils sont magnifiques et participent à l’expérience de vos œuvres.
MB : Les titres sont collectionnés, comme on collectionne des objets. Par exemple, nous avons croisé un panneau ferroviaire sur lequel était inscrit Le train ne siffle plus à cette intersection. Cette phrase est devenue le titre d’une œuvre. Pour nous, le titre ne fait pas qu’identifier l’œuvre, il en est un des matériaux.
YC : La littérature y compte pour beaucoup, pensons à Pnume. Instant d’éveil (1988), L’insoutenable (1993) ou encore Fragments d’un discours amoureux (2013). Ces titres sont inspirés des intitulés d’ouvrages de Jack Vance, Milan Kundera et Roland Barthes. Ce qui nous intéresse dans les titres, c’est leur dimension poétique. Nos titres suscitent aussi des questions par rapport à l’art comme dans Not to be used as a Life Saver (1990).
ADB : Un élément qui me fascine et que j’admire chez vous c’est que vous vous affranchissez, en tant qu’artistes, du regard des autres. Vous ne vous souciez pas ou très peu de la réception de votre travail au sens où vous créez selon vos envies du moment et non pas en fonction de ce qui pourrait être bien reçu par les institutions ou les acheteurs.
MB : Par le passé Yvon avait dit « nous autres on se fout du monde » et cela lui avait été reproché. En fait, tu as raison, on se fout du monde quand on est dans notre atelier, quand on produit, mais dans les faits, les gens nous intéressent, et ultimement on sait qu’on veut montrer notre travail.
YC : Cette liberté que nous avons est intimement liée au peu de commercialisation de notre production.
MB : C’est une des raisons pour lesquelles nous sommes restés avec Graff. Jamais la directrice, Madeleine Forcier nous a dit, « continuez dans cette lignée », il y a de l’intérêt pour ça. Jamais, jamais, jamais.
YC : Graff acceptait notre travail, même s’il était difficile à vendre. La galerie nous a permis d’être libres. Nous n’avons jamais fait la même exposition deux fois au cours de notre carrière. Nous sommes en train de faire l’inventaire de notre atelier et nous constatons que plusieurs œuvres n’ont été exposées qu’une seule fois. C’est ça aussi l’intérêt de cette rétrospective, de mettre en lumière des œuvres qui ont été moins vues.
ADB : Les œuvres de COZIC ont peut-être été peu achetées par des collectionneurs privés, mais les musées en ont quand même acquis plusieurs qui représentent bien votre travail. Je comprends par ailleurs que vous n’avez jamais réfléchi ou pensé à votre production en fonction de la vente ou de futures acquisitions.
YC : Nous voulons être dégagés de cette pression-là. Je compare notre attitude à celle des espèces animales. Les espèces animales se laissent approcher jusqu’à une certaine distance, ce qui s’appelle le point de fuite : soit l’animal fuit, soit il attaque. J’estime que notre point de fuite a été respecté jusqu’à maintenant. Il y a une très belle fable de Lafontaine, Le loup et le chien, qui illustre bien le propos. Le loup est famélique et le chien il est tout rondelet. « Moi je suis nourri tous les jours », dit-il. Le loup envie alors le chien. Mais tout à coup, il aperçoit que ce dernier a une marque au cou. Le chien lui explique que c’est la trace laissée par son collier, à partir duquel il est attaché. Le loup, estomaqué, dit alors préférer sa liberté à des repas copieux. Monic et moi, en tant qu’artistes, ressemblons davantage au loup.